Cormac McCarthy - No Country for Old Man
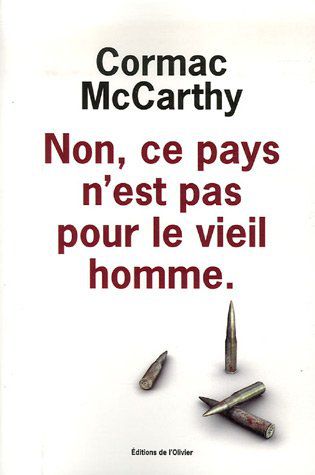
On ne présente plus l’écrivain américain désormais associé aux plus grands noms de la littérature américaine contemporaine. No Country for Old Men, publié en 2005 et écrit en quelque six mois de temps, fait suite à une interruption littéraire de l’écrivain de près de sept années. Il a été porté à l’écran par les frère Coen.
De quoi ça parle ?
J’ai lu dans un récent article du magasine Le Point (Nr1847 P17) que les pays du nord détenaient le monopole de la bonne conduite comparativement à leurs homologues européens. Explications. Un petit test vicieux a été monté dans diverses villes : on abandonne sciemment sur le trottoir d’une rue un portefeuille rempli d’argent avec l’adresse et les coordonnées de son propriétaire. Puis on guette la réaction du premier citoyen venu qui tombe dessus… Le classement n’est pas reluisant. Non plus que les réactions des pauvres quidams pris au piège. Si au Danemark et en Norvège, 100% des portefeuilles sont restitués, en Italie, on ne compte que 28% de restitution. La France, quant à elle, en onzième place sur quinze, affiche un petit 61%...
Et transposé en Amérique ?
Et bien, en Amérique, et pimenté sauce McCarthy, ce même test prend une toute autre envergure. C’est d’un gros portefeuille dont il s’agit. De plus de deux millions de dollars. Et là, si c’est un jeu, c’est un jeu mortel…
Car si, "pas vu pas pris", "vu pris puni"…
L’histoire
Llewelyn Moss, ancien vétéran du Vietnam établi au Texas dans une petite localité frontalière en bordure du Mexique, s’adonne à l’un de ses passe-temps par journée de grand soleil : la chasse à l’antilope dans le vaste désert rutilant qui s’étend au-delà du petit terrain qu’il occupe avec sa jeune épouse Carla Jean. Au détour d’une colline rocailleuse, Moss tombe sur une scène de carnage. Un convoi de véhicules tout-terrain criblés de balles. Des cadavres jonchant le sol poussiéreux. Des armes abandonnées alentour. Et non loin de cet épicentre de violence - où seul un survivant, prostré et blessé à mort dans le siège de sa camionnette remplie de sachets d’héroïne, soupire à l’agonie - à portée de main d’un cadavre encore chaud, déposée au pied d’un arbre comme l’ultime objet de toute tentation, une mallette. Lourde. Et pleine. Il ne faut pas longtemps à Moss pour se retracer le fil des évènements. Des passeurs de drogues… Un trafic ayant mal tourné… Et à présent, lui. Elément extérieur immiscé dans ce scénario. Arrivé au moment opportun. En équilibre sur un fil ténu. Moss a le choix. Moss a toujours le choix, et il l’aura toujours, jusqu’à la toute fin. Il pourrait tourner les talons. Il pourrait abandonner derrière lui ce sombre avenir en devenir : le prix que cette mallette ne manquera pas de lui coûter… Mais l’attraction est trop forte. Et Moss, ancien du Vietnam, est sûr de lui. Par excès de confiance en soi, il ne craint pas les embûches qu’on pourrait semer sur sa route… Alors, cette mallette, il l'ouvre. A l’intérieur, en rangée parfaitement alignée : des liasses de billets, coupures de cent dollars, pour une somme dépassant les deux millions. « Toute sa vie réduite à vingt kilos de papier dans une sacoche ». L’argent est un poison qui pervertit les âmes les plus fortes. Un « faux Dieu ». Moss ramène chez lui la mallette. Il croit avoir acheté sa liberté. Il vient d’ouvrir les portes de l’enfer. Dès lors, il s’embarque dans une cavale sans rémission. Toujours en mouvement et en vigilance. Fuyant les mexicains lancés à ses trousses. Fuyant surtout Chigurh. Tueur redoutable. Machine impavide autant qu’impitoyable. Le bras droit d’un Dieu malade. La main froide et divine qui s’abat implacablement sur ses victimes, et qui dérouille à pluie de douilles tous ceux osant se dresser sur son chemin. Et les morts s’entassent sur l’autel de la folie humaine. Et, tentant de juguler ce flot rutilant de sang chaud qui ne cesse de souiller le sable rouge de sa petite bourgade tranquille, le shérif Ed Tom Bell, vieux et usé, dépassé par les évènements, dépassé par toute cette violence qui envahit le monde - un monde qu’il arrivait à comprendre par le passé, mais qui lui devient de plus en plus opaque - le shérif Ed Tom, donc, contemple impuissant la lente mais non moins inexorable érosion d’une humanité en perdition qui se précipite vers sa fin et dont Chigurh incarne l’un des plus flamboyants instruments…
Le décor est posé. Les armes. Le feu. La poudre. Le sang. La violence comme contrepoint au désespoir et aux interrogations métaphysiques. Des dieux en fuite pour un monde en chute. Omniscience du déterminisme (pour ne pas dire du fatalisme) qui semble présider à la condition humaine. L’Amérique profonde comme terreau natal du mal… Les vastes étendues désertiques où l’homme blessé, relique claudicante du vieux cow-boy, s’en va cracher son dernier soupir. On est en terrain familier.
Bienvenu chez McCarthy.
Le bon, la brute, et le truand
…En lecture de surface, et présenté sous cet angle, la comparaison, facile, serait tentante. Avec un « bon » mollasson et contemplatif en la personne du shérif Ed Tom Bell, une « brute » méditative, en celle, inoubliable, de Chigurh, et un « truand » – qui ne le serait pas tant que ça, finalement – incarné par Moss.
Le bon, la brute, et le truand.
Mais ce serait réduire grandement l’oeuvre de l’écrivain que de cantonner No Country à cette simple vision de "western contemporain". De même qu’il serait naïf de l’interpréter comme une pièce aux relents réactionnaires ou strictement manichéistes (le Bien incarné par le shérif contre le Mal incarné par Chirugh…) ou comme un roman mettant en scène un jaillissement spontané de violence gratuite traité sur le mode de la complaisance. Car il n’y a jamais rien de gratuit chez McCarthy. Sous sa plume acérée, les personnages autant que les situations, les faits autant que les pensées qui animent les protagonistes, adoptent une perspective vertigineuse qui va bien au-delà de leur apparence première. L’écrivain décortique la mécanique de l’âme humaine. Il fore en profondeur la croûte de la conscience jusqu’à son noyau dur. Il plonge dans les profondeurs de l’âme humaine pour nous placer face à nos instincts sauvages, enfouis mais partagés. Pour nous les présenter nus, dépouillés. Pour nous imposer ce mal qui nous est immanent et que l’on cache sous le verni brillant de l’ordre social.
Moss pèche par faiblesse. Par orgueil autant que par concupiscence. A plusieurs reprises il a la possibilité de lâcher le magot qui, de rêves en devenir, devient pour lui un fardeau. Mais il s’y accroche. Obstinément. Désespérément. Car c’est le seul moyen pour lui d’aller à l’encontre de l’ordre établi des choses, de rompre avec la banalité de sa morne existence. Il préfère tenir tête à Chirugh. Il préfère prendre le risque. Quitte à mettre en péril la vie de ses proches…
Le shérif Bell pèche par résignation. Il aurait les moyens d’intervenir et de sauver des vies. Mais il ne le fait pas. Il préfère se « complaindre » dans une vision pessimiste et défaitiste d’un monde qui, selon ses propres paroles, part un peu plus chaque jour en déliquescence.
Finalement - et c’est là le paradoxe, mais aussi tout ce qui fait la force et la pertinence de ce No Country - s'il y a un personnage qui ne connaît ni le doute ni la faiblesse, qui dépasse ses propres instincts, s’il y a un personnage qui obéit à une ligne directrice toute tracée et qui se plie à des principes moraux supérieurs auxquels il ne démord pas, c’est bien Chirugh. Le tueur. McCarthy, en l’affublant à plusieurs reprises d’un caractère « surnaturel » (un « fantôme » P285 qui disparaît et apparaît lorsque bon lui semble ; une « ombre » qui se glisse dans l’obscurité et qui échappe à toute traque ; un être « invincible » P134…) l’érige au rang de figure allégorique se posant comme l’incarnation non pas du Mal, mais de l’instrument d’un déterminisme absolu présidant à toute chose et à toute existence. Une sorte de main de Dieu, implacable, qui prépare le terrain d’une apocalypse à venir : « Y’a quelque part un prophète de la destruction bien réel et vivant, et je ne veux pas avoir à l’affronter. » (P8). Traitement allégorique qui n’est évidemment pas nouveau chez l’écrivain (Cf. : ma chronique de la Route ou de Méridien de Sang).
Sous ses allures de western moderne, No Country se révèle donc bien plus qu’un simple « divertissement ». Et si l’on voulait le désigner par ce qualificatif, il serait plus juste de lui accoler l’adjectif « métaphysique » pour bien rendre compte de toute la subtilité qui le caractérise.
Conclusion
On soulèvera simplement, pour finir, une proportion autobiographique possible du récit qu’il serait amusant de démêler de la trame fictionnelle, McCarthy ayant lui-même vécu dans la petite localité d’El Paso, quelques années durant, avec sa jeune et troisième épouse. On notera enfin ce remarquable fil conducteur qui relie No Country à The Road, le premier empreint d’un fatalisme pesant qui s’exprimera pleinement, et dans toute sa force amère, au travers du second. A cette égard, la scène de clôture de No Country est une parfaite préfiguration de La Route à venir : le shérif Bell rêve de son père. Dans son rêve, ce dernier, chevauchant sur une route, le devance en brandissant une lumière : « Et dans le rêve je savais qu’il allait plus loin et qu’il voulait allumer un feu quelque part là-bas dans tout ce noir et dans tout ce froid et je savait que n’importe quand j’y arriverais il y serais. » (P299). Le symbole du feu… La relation du père et de son fils. Tout est dit.
Extraits
« A cet endroit, les rochers sont couverts de pictogrammes gravés dans la pierre il y a peut-être un millier d’années. Les hommes qui les ont dessinés, des chasseurs, comme lui. De ces hommes-là, il n’y a pas d’autres traces. » (P16)
« Je vais faire la pire connerie de ma vie, mais je vais la faire quand même. Si je ne reviens pas, dit à ma mère que je l’aime.
Ta mère est morte, Llewelyn.
Alors, j’irai lui dire moi-même. » (P27)
« Détourne pas les yeux. Je veux que tu me regardes.
Il regarde Chigurh. Il regarde le jour nouveau qui commence tout autour à pâlir. Chigurh lui tire une balle en plein front puis reste là à regarder. A regarder les capillaires exploser dans ses yeux. La lumière qui recule. A regarder sa propre image se dissoudre dans ce monde en perdition. » (P117)
« Bell opine la tête. Il boit son café à petites gorgées. Le visage qui tremble et bouge dans le liquide noir de la tasse semble un présage de choses à venir. Des choses qui perdent leur forme. Qui vous emportent avec elles. » (P123)
« Vous connaissez bien Chigurh ?
Assez bien.
Ce n’est pas une réponse.
Qu’est-ce que vous voulez savoir ?
L’homme tambourine sur le bureau avec les phalanges. Il lève les yeux. J’aimerais seulement savoir quelle opinion vous avez de lui. En général. L’invincible M. Chigurh.
Personne n’est invincible.
Il y a quelqu’un qui l’est.
Pourquoi dites-vous ça ?
Quelque part au monde il y a l’homme le plus invincible. De même qu’il y a quelque part le plus vulnérable.
C’est ce que vous croyez ?
Non. Ça s’appelle la statistique. » (P134)
« Savez-vous qui est cet homme ?
Non. Je suis censé le savoir ?
Parce que ce n’est pas le genre de personne qu’on aurait envie de connaître. Les gens qui le rencontrent ont en générale très peu d’avenir. Pas d’avenir du tout, en réalité. […] Vous croyez que vous l’avez tué ?
J’en sais rien.
Parce que vous ne l’avez pas tué. Il est allé dans la rue et il a tué tous les Mexicains les uns après les autres et ensuite il est retourné dans l’hôtel. Comme un type qui irait chercher le journal ou quelque chose.
[…] Qu’est-ce qu’il est censé être, ce type, le suprême salaud ?
Je ne crois pas que c’est comme ça que je le décrirais.
Comment le décririez-vous.
Wells semble réfléchir. Je crois que je dirais qu’il n’a pas le sens de l’humour. […] Vous ne pouvez pas passer de marché avec lui. Permettez-moi de me répéter. Même si vous lui donniez l’argent il vous tuerait. Il n’y a personne sur cette planète qui ait jamais eu ne serait-ce qu’un mot de travers avec lui. Ils sont tous morts. Ce n’est pas bon signe. C’est un type hors norme. On pourrait presque dire qu’il a des principes. Des principes qui transcendent l’argent ou la drogue ou tout ce que vous voudrez de ce genre. » (P142-146)
« Chirugh regarde par la fenêtre, le fusil sur les genoux. D’être blessé m’a changé, dit-il. M’a fait changer de perspective. Ça m’a fait avancer, en un sens. Certaines choses se sont mises en place qui n’étaient pas là avant. Je croyais qu’elles étaient là, mais elles ne l’étaient pas. La meilleure façon de le dire, c’est qu’en quelque sorte, j’ai fini par me trouver. Ce n’est pas une mauvaise chose. Il était grand temps. […] Ça a commencé bien avant, dit-il. Je ne m’en suis pas rendu compte tout de suite. Quand je suis arrivé à la frontière, je me suis arrêté à un café dans ce bled et il y avait des types dans le café en train de boire de la bière et il y en avait un qui n’arrêtait pas de se retourner sur moi. Je n’y ai pas fait attention. J’ai commandé mon déjeuner et j’ai mangé. Mais quand je suis allé au comptoir pour payer l’addition il a fallu que je passe à côté d’eux et ils étaient tous là à ricaner et ce type a dit quelque chose qu’il était difficile de faire semblant de ne pas entendre. Tu sais ce que j’ai fais ?
Ouais. Je sais ce que tu as fais.
J’ai fait semblant de n’avoir rien entendu. J’ai payé mon addition et j’allais passer la porte quand il a répété la même chose. Je me suis retourné et je l’ai regardé. J’étais là en train de me curer les dents avec un cure-dents et je lui ai fait un petit signe de tête. Pour qu’il sorte. S’il en avait envie. Et je l’ai attendu sur le parking et lui et ses amis sont arrivés et je l’ai tué sur le parking et ensuite je suis monté dans ma voiture. Ils étaient tous agglutinés autour de lui. Ils ne comprenaient pas ce qui était arrivé. Ils ne comprenaient pas qu’il était mort. Il y en a un qui a dit que je lui avais fait la prise du sommeil et aussitôt les autres ont tous dit la même chose. Ils essayaient de l’asseoir. Ils lui donnaient des gifles et ils essayaient de le faire asseoir. Une heure plus tard, j’ai été contrôlé par un adjoint du shérif aux environs de Sonora, Texas, et je l’ai laissé me conduire en ville avec les menottes aux poignets. Je ne suis pas certain de savoir pourquoi j’ai fait ça mais je crois que je voulais voir si je pouvais me sortir d’un mauvais pas par la force de la volonté. Parce que je crois qu’on le peut. Qu’une chose comme ça est possible. Mais c’était idiot de ma part. Quelque chose de gratuit. Tu comprends ?
Si je comprends ?
Oui.
Tu te rends compte quel putain de taré tu fais ?
A cause de la nature de cette conversation ?
De ta nature à toi.
Chigurh se carre dans son fauteuil. Il examine Wells. Dis mois quelque chose dit-il.
Quoi.
Si la règle que tu as suivie t’amené où tu en es à quoi elle t’as servi ta règle ?
Je ne sais pas de quoi tu parles.
Je parle de ta vie. Où tout est maintenant visible d’un seul coup.
[…] Tu crois pouvoir échapper à tout, dit Wells. Mais tu te trompes.
Pas à tout, non.
T’échappera pas à la mort.
Ça n’a pas le même sens pour moi que pour toi.
[…] Wells regarde dehors dans la rue. Quelle heure est-il ? dit-il.
Chirugh lève son poignet et regarde sa montre. Onze heures cinquante-sept, dit-il.
Wells opine la tête. D’après le calendrier de la vieille Mexicaine il me reste encore trois minutes alors à Dieu va. Je crois que je voyais tout ça venir depuis longtemps. C’est presque comme dans un rêve. Du déjà vu. Il regarde Chigurh. Tes opinions ne m’intéressent pas, dit-il. Allez vas-y. Enfoiré de psychopathe. Vas-y et va te faire foutre.
Il ferme les yeux. Il ferme bel et bien les yeux et il tourne la tête et il lève une main pour détourner ce qui ne peut être détourné. Chigurh lui tire une balle en pleine figure. Tout ce que Wells a jamais connu ou pensé ou aimé s’évacue lentement sur le mur derrière lui. Le visage de sa mère, sa première communion, les femmes qu’il a connues. Les visages d’hommes en train de mourir à genoux devant lui. Le corps d’un enfant mort dans un fossé au bord d’une route dans un autre pays. Il gît à moitié décapité sur le lit les bras écartés, avec sa main droite dont il manque la plus grande partie. Chigurh se lève et ramasse la douille vide sur le tapis et souffle dedans et la met dans poche et regarde sa montre. Il reste encore une minute jusqu’au lendemain. » (P166-171)
« Llewelyn, je ne veux même pas de cet argent. Je veux simplement qu’on soit de nouveau tous les deux comme avant.
On le sera.
Non, on le sera pas. J’y ai réfléchi. C’est un faux dieu.
Ouais. Mais c’est de l’argent, et du vrai. » (P173)
« Je m’en veux. J’aurais jamais cru que ce fils de pute remettrait les pieds ici. J’ai même jamais imaginé une chose pareille.
Il n’est peut-être jamais parti.
J’ai eu la même idée.
Si personne ne sait à quoi il ressemble c’est que personne ne vit assez longtemps pour le dire.
C’est un tueur fou, Ed Tom.
Ouais. Mais je ne crois pas que c’est un fou.
Alors comment appeler ça ?
J’en sais rien […]. » (P182)
« Vous n’avez pas à vous faire de bile. Il ne viendra personne d’autre.
Comment le savez-vous ?
Parce que c’est moi qui décide qui vient qui ne vient pas. Je crois que nous sommes ici pour aller au fond des choses. Je ne veux pas perdre trop de temps à vous rassurer. Je crois que ce serait aussi vain qu’ennuyeux. Alors parlons de l’argent.
[…]Qu’est-ce qui est arrivé aux anciens ?
Ils sont passés à autre chose. Tout le monde n’est pas fait pour ce genre de travail. La perspective de profits démesurés incite les gens à surestimer leurs propres aptitudes. Dans leur esprit. Ils se flattent de pouvoir maîtriser les évènements alors qu’ils en sont sans doute incapables. Et c’est toujours la façon dont nous nous comportons en terrain miné qui attire l’attention de nos ennemis ou les décourage.
Et vous ? Parlez-moi un peu de vos ennemis.
Je n’ai pas d’ennemis. C’est une chose que je ne tolère pas. » (P238 et 240).
« Même un athée pourrait trouver utile de suivre le modèle de Dieu. » (P242)
« De toute façon vous ne m’auriez pas laissée échapper.
Je n’ai pas voix au chapitre. Chaque instant de votre vie est un tournant et chaque instant un choix. Quelque part vous avez fait un choix. Tout a découlé de là. La comptabilité est rigoureuse. La forme est tracée. Aucune ligne ne peut être effacée. Je n’ai jamais cru que vous aviez le pouvoir de faire tourner une pièce à votre guise. Comment le pourriez-vous ? En ce monde chacun suit son chemin et il est rare qu’on en change et encore plus rare qu’on en change brutalement. Et le tracé de votre chemin était visible depuis le début. » (P245)
« Quand on a une mission comme celle-là on doit accepter qu’il faudra vivre avec les conséquences. Mais on ne sait pas ce que seront les conséquences. Au bout du compte on prend à sa charge un tas de choses auxquelles on n’était pas préparé. Si je devais mourir là-bas en faisant ce que j’avais donné ma parole de faire eh bien c’est ce que j’aurais dû faire. Tu peux tourner les choses de la manière que tu voudras mais c’est comme ça. C’est ce que j’aurais dû faire et que je n’ai pas fait. Et il y a une part de moi qui a toujours souhaité pouvoir revenir en arrière. Et je ne peux pas. Je ne savais pas qu’on pouvait voler sa propre vie. Et je ne savais pas que ça ne rapportait pas plus gros que n’importe quoi d’autre qu’on pourrait voler. Je crois que j’ai mené ma vie le mieux que je pouvais mais ce n’était quand même pas la mienne. Ça ne l’a jamais été. » (P262)
« Le jeune homme regarde ses baskets. Il lève les yeux sur Bell. Il n’avait pas l’air de n’importe qui. Ce que je veux dire c’est qu’il n’y avait rien d’extraordinaire dans son apparence. Mais il n’avait pas l’air de quelqu’un avec qui on voudrait avoir des histoires. Quand il disait quelque chose on était sûr d’écouter. Il avait un os du bras qui lui sortait de la peau et il n’avait pas du tout l’air de s’en inquiéter. » (P276).
